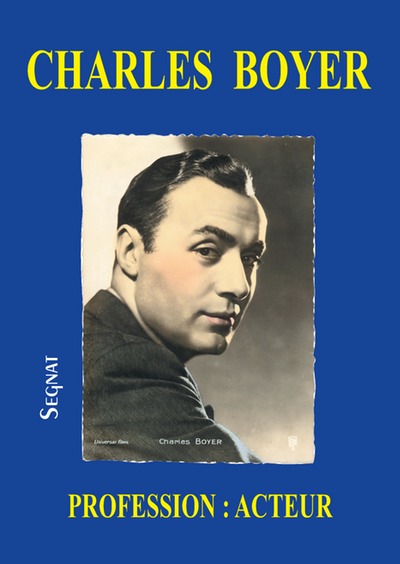Extrait de « Charles Boyer, profession : Acteur. (Segnat Éditions).

1899 - En ce temps là, Figeac n’était qu’une petite et modeste sous-préfecture, assoupie dans ses vieilles pierres et ses crépis délavés. Ses édiles municipaux, en quête de grandes réalisations novatrices, n’avaient pas encore entrepris d’abattre tout un quartier urbain à seule fin d’en faire une place publique. A Paris, les frères Lumière venaient tout juste (le 28 décembre 1895) de faire, dans les sous-sols d’un grand café parisien, leur première projection de L’arroseur arrosé et de La sortie des usines Michelin.
Ce fut alors que naquit Charles Boyer, dans une grande maison bourgeoise du boulevard Labernade ; un enfant prématuré de 2 kilos 200. La naissance eut lieu le lundi 28 août 1899, jour de la saint Augustin. Le père, Maurice, aurait aimé devenir avocat et collectionnait de ce fait aussi bien les ouvrages classiques que les livres de droit. La mère, Augustine, Marie, Louise, était habile au jeu de la harpe et n’hésitait pas, sur invitation pressante de son entourage, à chanter haut et fort quelqu’air connu d’opéra…
Le petit Charles fit ses premiers pas dans les ateliers de « construction en fer, cuivre et tôle », et le magasin de «vente de fourneaux de cuisine, charrues brabant, faucheuses et moissonneuses-batteuses » de Papa Boyer, un homme qui eut toujours de l’affection pour son fils sans posséder, toutefois, l’art de l’exprimer. Ce fut, au sein même de l’entreprise familiale, «fondée en 1812», que l’enfant révéla bientôt ses dons artistiques. La légende veut qu’à trois ans, juché sur un comptoir, il aurait devant une clientèle étonnée, mais ravie, déclamé tout un texte sur la Crucifixion. De cela, Charles Boyer, devenu adulte, ne put jamais se souvenir.
« Je ne sais pas, confia-t-il un jour, comment cette histoire a démarré. J’ai eu toutefois, très tôt, une excellente mémoire me permettant, encore aujourd’hui, de me souvenir de mon enfance et des événements qui la marquèrent. »
Ce qui est sûr, c’est qu’il revint à Louise Boyer le privilège d’apprendre à lire à son fils. Bien avant d’entrer en maternelle, à l’école Jeanne d’Arc de la ville, Charles Boyer était capable de réciter son alphabet et de lire Shakespeare à haute voix. Un petit génie ? Certes pas. L’enfant ne se distingua jamais des autres dans le domaine culturel. Attiré par les activités physiques, il montrait toutefois un caractère quelque peu fermé ; introverti, pourrait-on dire.
« J’étais sociable, mais je ne prisais pas tellement la compagnie des enfants de mon âge. Je faisais figure d’un vieillard dans un corps de petit garçon. La compagnie des adultes me convenait mieux…»
Charles Boyer n’avait pas encore atteint l’âge de sept ans qu’il se trouva effectivement juché sur le comptoir du magasin paternel. Il s’agissait de réciter publiquement, à qui se trouvait là pour l’entendre, quelques longues tirades en vers dues, notamment, au poète François Villon. Le succès fut très grand.
L’enfant venait d’entrer dans la plus petite des classes du collège Champollion où il devait effectuer ses études primaires puis ses études secondaires jusqu’au baccalauréat. Ses dispositions pour la « récitation » lui valurent rapidement d’être choisi pour paraître sur scène dans toutes les présentations poétiques, littéraires ou théâtrales de l’établissement ; celles-ci furent, semble-t-il, fort nombreuses.
« C’est ainsi que jusqu’à ma sortie du collège, je devais être un des plus fidèles protagonistes de ces spectacles, dont le programme devenait, d’année en année, plus copieux et plus ambitieux. Nous jouions Molière, Cyrano, L’Aiglon, Le voyage de M. Perrichon.
« Je tenais tous les premiers rôles avec un absolu dédain des emplois. Perrichon et Cyrano dans la même soirée, voire Metternich, n’étaient point pour me faire peur. »
Si le jeune Charles excellait sur les planches, il n’en était pas de même dans les autres matières de l’enseignement classique qui lui était prodigué. Ne revendiquant pas, ouvertement, la dernière place, réservée aux cancres, il ne disputa jamais à quiconque la première ou la seconde.
« J’aimais jouer, travailler à condition que je ne m’en aperçoive pas, distribuer à l’occasion des coups de pieds dans les tibias de mes petits camarades, ou leur tirer quelque peu les cheveux, quitte à subir le même traitement d’une âme égale… »
A l’âge de dix ans, Charles Boyer connut sa première épreuve. Son père, alors âgé de trente-cinq ans, mourut subitement d’une attaque d’apoplexie. Sa mère entreprit de l’élever, seule, en lui donnant la meilleure éducation bourgeoise qui fût. Ainsi Charles prit-il ses premières leçons privées de violon – instrument qu’il mania, avec dextérité et talent, tout au long de sa vie.
S’il découvrit, fortuitement, les aventures de Max Linder pour lesquelles il se passionna, dans quelque cinéma ambulant de l’époque, il n’échappa pas à une première visite au théâtre de Toulouse où, dans une pièce due à un certain Henry Bernstein, intitulée Samson, se produisait le Grand Lucien Guitry. Ce fut d’ailleurs, là, une révélation.
L’acteur parisien eut, dès l’abord, une profonde influence sur l’imagination et la détermination du jeune figeacois. Interrogé à l’occasion de sa première communion sur son avenir, celui-ci devait répondre publiquement : « Je serai acteur, tout comme Lucien Guitry ! » Ce qui ne fut guère du goût de Madame Boyer qui voyait déjà en son fils un prêtre, un médecin ou un avocat.
Acteur, Charles Boyer le fut bientôt dans les dépendances de la maison familiale où il entreprit de monter, avec quelques camarades, une version toute personnelle du Macbeth de William Shakespeare. En l’absence de filles, Charles jouait lui-même le rôle de Lady Macbeth. La production connut un certain succès auprès des parents qui acceptèrent de payer leur place pour voir jouer leur progé- niture.
Plus fier de lui-même que du jeu de ses partenaires, Charles aurait aimé donner de nouvelles représentation, mais sa troupe se disloqua bien vite, attirée par d’autres occupations récréatives. Seule, au milieu d’une salle vide, la future vedette cinématographique s’amusa dès lors à apprendre les longs monologues du théâtre classique et à les déclamer à la façon de son idole, Lucien Guitry.
En 1913, alors qu’il atteignait ses quatorze ans, Charles Boyer découvrit Paris avec sa mère et eut le privilège de voir sur scène Sacha Guitry — qu’il trouva toujours inférieur à son père, alors en tournée provinciale. Sa détermination s’établit à ce moment de façon définitive : il serait plus tard acteur, à Paris où, affirma-t-il, « l’on ne saurait être médiocre ».
Survint la guerre opposant la France et ses alliés aux forces germaniques et austro-hongroises. Ceci au moment même de son quinzième anniversaire. Chacun pensait que le conflit ne durerait que quelques semaines, au pire quelques mois…
En 1916, bien que Figeac fût à des lieues des combats, son hôpital devint un centre de repos et de convalescence pour les blessés du front. Charles Boyer se porta volontaire, avec un camarade, pour assurer le divertissement des troupes, mêlant le chant, la musique et la déclamation. Ce fut aussi le temps de la préparation du baccalauréat :
« Ah ! Cette année de philosophie, la dernière que je passai dans ce cher collège de Figeac, quels bons souvenirs elle me laisse : de longues rêveries empreintes de ce charme unique et si subtil de l’adolescence, de lectures au coin du feu ou, aux beaux jours, à plat ventre dans l’herbe parfumée, de fiévreuses discussions !…
« Nous étions quatre en philo. Vers la fin du premier trimestre, notre professeur dut nous quitter, non sans émotiono: il était mobilisé. il fut remplacé par une « licenciée ès lettres » de vingt ans, fort jolie. Nos dissertations sur les passions et les sensations étaient plus des déclarations voilées que des devoirs d’élèves. »
Les anciennes loges de l’ancien Théâtre municipal portent, encore aujourd’hui, témoignage d’une soirée artistique du collège Champollion offerte en 1916 au public figeacois. A côté du nom de Metternich, personnage central de L’Aiglon, figure, dans le plâtre du mur, celui de Charles Boyer…
Ayant passé, avec succès, son baccalauréat au début de l’été 1917, à Cahors pour l’écrit et à Toulouse pour l’oral, le jeune homme dut se résoudre à choisir sa voie. Celle-ci, dressée sous l’autorité de sa mère, ne laissa point de place à la récréation ou au théâtre. Il fut ainsi formellement convenu que Charles irait fréquenter la Sorbonne de Paris pour y acquérir les diplômes de philosophie nécessaires au professorat.
« Cette perspective n’avait rien pour moi que de fort plaisant. Je ne connaissais pas Paris, et j’étais enchanté de faire sa connaissance. En outre, vite oublieux des douces années passées à Figeac, je n’étais pas fâché, et il me paraissait urgent de vivre une existence plus libre et plus mouvementée.
« Enfin, j’étais bien décidé à m’introduire dans les milieux de théâtre et, le cas échéant, à tenter ma chance… »
Pour réussir dans la vie, Charles Boyer possédait alors quatre cartes majeures : un diplôme, une volonté tenace, une mémoire patiemment cultivée, enfin une prestance de jeune homme bien élevé.
Guy Chassagnard